« C’est de l’eau », et les réponses aux questions qu’on ne se pose pas
« Je vous souhaite bien plus que de la chance. »
Le 21 mai 2005, l’essayiste et romancier américain David Foster Wallace s’est avancé vers un podium pour s’adresser à une cohorte nouvellement promue d’étudiants du Kenyon College, un établissement d’enseignement des sciences humaines situé à Gambier, en Ohio. Une fois que les applaudissements polis se furent doucement essoufflés, David Foster Wallace entama une allocution d’un peu plus d’une vingtaine de minutes. Vingt-deux minutes, pour être exact, dans lesquelles il tint un discours d’une justesse et d’une authenticité déconcertantes, à l’image de son titre : C’est de l’eau.
Lorsque j’ai appris qu’on allait me confier une chronique littérature, mon premier réflexe a été de me questionner sur l’ouvrage qui devrait faire l’objet de mon tout premier texte. Ce choix n’avait rien d’anodin : il m’apparaissait essentiel de choisir une œuvre qui puisse faire office de coup d’envoi de ce périple que je souhaite partager avec mes lecteurs dans les mois à venir. Ma profession de foi, en quelque sorte, envers la littérature et ce qu’elle peut nous apporter.
« C’est de l’eau, alors ? Ben oui. »
̶ Transcription fidèle et intégrale de mon débat intérieur à ce moment-là ̶
C’est de l’eau tient son titre de la parabole avec laquelle Wallace entame son allocution aux diplômés du Kenyon College: dans l’immensité de l’océan, deux jeunes poissons en croisent un plus vieux qui leur demande si l’eau est bonne ; perplexe, l’un des jeunes demande à l’autre « Tu sais ce que c’est, toi, de l’eau ? »
Après tout, pourquoi des poissons ayant vécu toute leur vie dans un environnement aquatique devraient-ils ̶ ou même pourraient-ils ̶ être conscients de ce qu’est l’eau ? Pour savoir ce qu’est l’eau, encore faudrait-il pouvoir la distinguer de l’air, du sol, du feu, du vide… Mais comment faire s’ils nous sont tous étrangers ? Ironiquement, quand on ne perçoit le monde qu’à travers une seule perspective, la nature exacte de ce cadre tend à nous échapper :
« La morale immédiate de cette histoire est tout simplement que les réalités les plus évidentes, les plus omniprésentes et les plus importantes, sont souvent les plus difficiles à voir et à exprimer. »
Comment connaître les limites du monde qui nous entoure quand on ne sait pas où débute ce qui lui est extérieur ? À notre manière, nous sommes ces poissons, et l’eau dans laquelle nous sommes si immergés que nous en oublions l’existence est notre propre subjectivité. Nous sommes au centre de tout ce qui nous arrive, c’est assez évident, mais ce qui l’est moins, c’est notre tendance à oublier que nous ne sommes pas le centre de l’univers, et qu’il est des pans complets de la réalité qui n’ont rien à voir avec nous :
« Ce que je veux dire, c’est que le mantra des sciences humaines de “m’apprendre à penser” signifie en partie être un tout petit peu moins arrogant, avoir une “perception critique” de moi-même et de mes certitudes… parce qu’un énorme pourcentage des trucs dont j’ai tendance à être certain se révèle complètement faux et illusoire. »
Dans les mots de Wallace, une visite au supermarché après une longue journée au bureau, événement d’une banale et frustrante platitude, devient l’occasion de faire le choix conscient de se mettre à la place d’autrui. De faire l’effort de sortir de notre « configuration par défaut » qui nous pousse à croire que nous sommes le nombril de notre propre monde.
C’est de l’eau est une lecture aussi percutante et essentielle qu’elle peut être courte et accessible. On parle d’un texte de 131 phrases en autant de pages. Oui, oui : vous avez bien lu. Ici, à chaque énoncé sa page propre, car dans C’est de l’eau les phrases bénéficient d’être prises une par une, délicatement et avec révérence pour en saisir tout le poids ; lues comme on dégusterait les chocolats fins d’une boîte payée à prix fort, plutôt qu’engouffrées à la manière d’une poignée de Tic Tac.
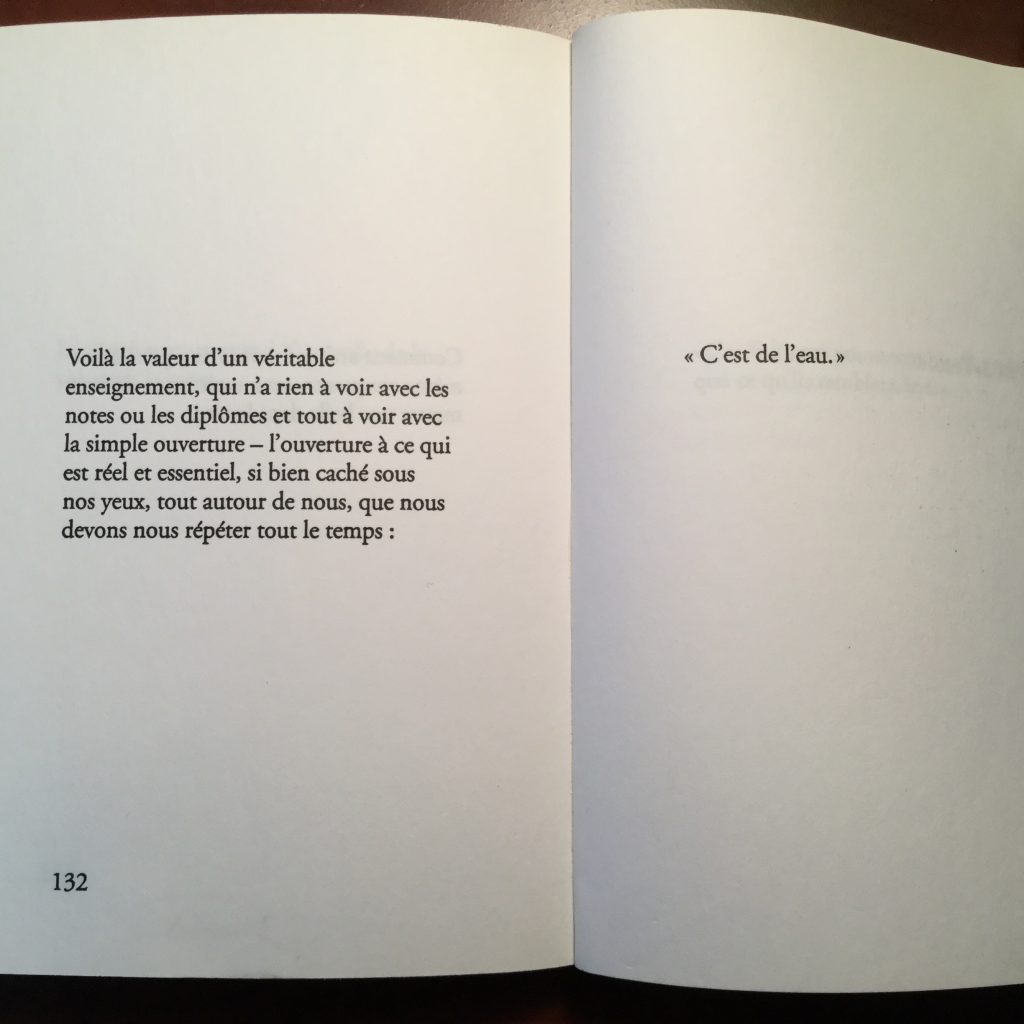
Extrait de C’est de l’eau 
David Foster Wallace – Crédit Photo: animalnewyork.com
Si vous êtes, comme moi, un lecteur plutôt lambineux, C’est de l’eau de David Foster Wallace vous prendra, au bas mot, un peu plus d’une demi-heure ; un investissement de temps dérisoire vu la pertinence du propos.
À une époque où l’on semble avoir oublié l’importance de prendre un pas de recul pour élargir nos perspectives, la pertinence du message de David Foster Wallace se voit décuplée. Alors que le discours ambiant tend de plus en plus vers l’individualisme et les jugements de valeurs basés sur des observations superficielles, la lecture de C’est de l’eau devient d’autant plus essentielle pour nous rappeler l’importance de l’empathie, de la compassion et de l’humilité dans nos rapports avec nos prochains.
Pourquoi consacrer ma première chronique littéraire à C’est de l’eau, donc? Parce je suis convaincu que c’est dans cette chance qu’elle nous offre de marcher dans les souliers d’un autre que la littérature trouve toute sa valeur : grâce à la lecture, nous pouvons vivre par procuration des émotions que nous n’aurions peut-être jamais ressenties, sortir de la prison dans laquelle nous enferme notre subjectivité pour voir le monde à travers des yeux qui ne sont pas les nôtres, pour une fois.
C’est de l’eau est porteur d’espoir pour tous ceux qui croient encore qu’il soit possible de nous défaire de nos œillères égoïstes. Cependant, la communication de cet espoir passe par une mise en garde à l’endroit du poids de ces certitudes qui nous tirent vers le bas et nous empêchent de connecter avec nos semblables autant que nous le pourrions, et qui rend d’autant plus tragique le destin de son auteur qui nous a quittés beaucoup trop tôt.




