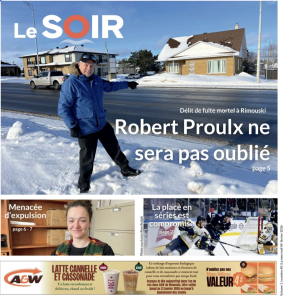L’Institut Maurice-Lamontagne dévoile ses secrets
Au coeur de la recherche marine
Dans les installations de l’Institut Maurice-Lamontagne, à Mont-Joli, des chercheurs scrutent les changements de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent.
Avec ses quelque 550 scientifiques, le centre de recherche de Pêches et Océans Canada constitue un laboratoire vivant où se dessinent les enjeux cruciaux de nos écosystèmes marins.
Les données collectées depuis trois décennies par Peter Galbraith et son équipe révèlent une réalité alarmante.
« Depuis 2008, on voit un réchauffement des eaux de profondeur en raison de deux grands courants qui entrent du détroit de Cabot », explique la guide, Mariane Caplette.
Le phénomène s’est accentué.
« En 2023, un apport de 100% des eaux du Gulf Stream est entré », indique l’étudiante universitaire. Cette situation exceptionnelle inquiète les scientifiques, car les eaux du Gulf Stream sont « plus chaudes, riches en nutriments, mais n’ont pas beaucoup d’oxygène », contrairement aux eaux froides du Labrador.
La migration des baleines suit les bouleversements
Ces changements océanographiques ont des répercussions directes sur la faune marine.
« Depuis 2015, on remarque un changement sur le plan de la composition de la nourriture pour les baleines », fait remarquer la future scientifique.
Cette transformation explique la présence accrue de baleines noires. Or, comme la baleine noire suit la nourriture, c’est ce qui explique que, depuis 2015, il y en a beaucoup plus qu’avant dans le Saint-Laurent.
Face à cette situation, l’Institut a développé une réglementation.

« Quand on identifie une baleine noire, des mesures de protection sont mises en place pendant 15 jours, spécifie Mariane. On parle de réduction de la vitesse des navires. Il y a aussi fermeture de la zone de pêche où on a observé la baleine. » Les résultats sont encourageants. « Ça fonctionne parce que, depuis 2020, il n’y a pas eu de mortalités de baleines noires », se réjouit-elle.
L’Institut Maurice-Lamontagne peut également se vanter de succès remarquables, notamment concernant le béluga.
« L’équipe de la chercheuse Véronique Lesage a réussi àfaire un lien entre la qualité de l’eau et les cancers chez les bélugas, explique la future scientifique. Avec l’augmentation de mesures de gestion de la qualité de l’eau, il n’y a plus de cancers chez les bélugas. »
La menace des espèces envahissantes
Les chercheurs sont préoccupés par les espèces envahissantes qui menacent l’équilibre écologique. « Une espèce envahissante a plusieurs impacts négatifs, notamment sur l’environnement », souligne l’étudiante en biologie, qui ajoute qu’il est de la mission des scientifiques de sensibiliser la population aux gestes de prévention à poser.
Parmi ces espèces, la moule zébrée pose des défis. « On travaille beaucoup avec les municipalités pour instaurer des mesures de contrôle. Celles-ci coûtent beaucoup plus cher que la prévention. »
Le centre de recherche déploie des technologies impressionnantes pour surveiller le fleuve.

« Le Service hydrographique du Canada produit et met à jour les cartes marines, indique Mariane. Dans les cartes dynamiques, on voit notamment l’influence des courants et les cycles des marées pour une navigation complète. »
La salle des bassins abrite une véritable arche de Noé marine, où cohabitent femelles homards gestantes, oursins, loups tachetés et plusieurs autres espèces étudiées. Le système de pompage traite 70 000 litres à chaque heure d’eau de mer pour recréer les conditions naturelles.
Incursion au cœur de la recherche et de l’innovation
Jusqu’à la fin de l’été, l’Institut Maurice-Lamontagne invite les visiteurs à découvrir les travaux réalisés dans ses murs et en mer.
Une visite guidée gratuite permet d’en apprendre davantage sur la recherche, l’innovation et la protection des milieux aquatiques de ce haut lieu de la science de Pêches et Océans Canada.
Mariane Caplette, étudiante en biologie à l’Université du Québec à Rimouski, guide les visiteurs vers une vingtaine de stations de l’établissement nommé en l’honneur d’un sénateur originaire de Mont-Joli, Maurice Lamontagne, pour qui la science devait être accessible à tout le monde, dont aux personnes défavorisées.
Le Soir a participé à la visite guidée, qui a notamment permis d’entrer dans la salle des bassins, l’une des plus vastes au Canada, ainsi que dans l’atelier des navires de la Garde côtière canadienne.

Cette incursion au cœur du plus grand centre de recherche francophone de Pêches et Océans Canada permet d’en apprendre davantage sur les aires marines protégées, les changements climatiques et les impacts des activités humaines sur nos milieux aquatiques.
Les visites guidées de 60 minutes sont offertes gratuitement jusqu’au 22 août. Il faut réserver par téléphone au 418-775-0870 ou par courriel à [email protected].