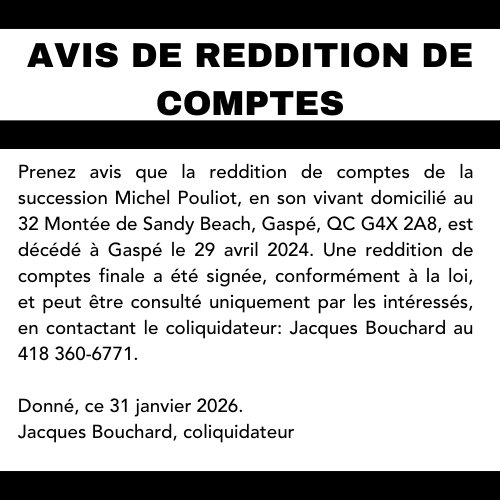Place aux jeunes : enraciner une nouvelle génération
Ses agents accompagnent avec succès plus de 200 nouveaux travailleurs chaque année
Chaque année, les agents de Place aux jeunes, actifs dans les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, accompagnent avec succès plus de 200 nouveaux travailleurs qui souhaitent s’installer dans la région.
L’organisme a été créé il y a une trentaine d’années pour freiner l’exode vers les grands centres. Et ça fonctionne.
L’image était forte. En 1990, l’équivalent d’un autobus de jeunes par semaine quittait l’Est-du-Québec pour les grands centres urbains.
Les prévisions démographiques annonçaient alors un lent déclin des régions au profit de la métropole.
C’est dans ce contexte que Place aux jeunes a vu le jour pour renverser la tendance et convaincre les moins de 35 ans de revenir.
« On voulait remplir des autobus de jeunes pour les ramener en région », se souvient l’agent de migration de Rimouski-Neigette, Martin Poirier.
Série de visites et de rencontres
Les séjours exploratoires comprenaient une série de visites et de rencontres afin d’attirer de nouveaux résidents. Aujourd’hui, les moyens ont changé. L’accompagnement est plus individualisé et directement lié aux besoins des entreprises en main-d’œuvre spécialisée.
Les employeurs recrutent et, lorsqu’un candidat vient en entrevue, Place aux jeunes s’occupe de son séjour et met en valeur les atouts de la région.
« L’emploi, c’est le prétexte. La vraie question est à quoi ressemblera ma vie, ici, après 17 h ? Est-ce qu’il y a une boulangerie, des écoles, une université, du sport, une vie culturelle ? Nous, on s’assure qu’ils n’aient pas envie de repartir », soutient monsieur Poirier.

Dans le Kamouraska, l’approche mise davantage sur l’enracinement.
« Ce sont souvent des gens déjà installés ici ou nouvellement arrivés. Place aux jeunes organise des tournées en autobus pour favoriser le réseautage et l’intégration », explique l’agent de migration, Louis Lahaye Roy.
Fleuve et grands espaces
Andrée Sano-Gélinas est arrivée à Rimouski, il y a 10 ans.
« À Montréal, j’étais comme toute pognée, je n’avais pas d’horizon. Au sens propre. Ici, avec le fleuve, les grands espaces et la nature, c’est différent. Mais il y avait aussi de la place pour m’impliquer dans des projets, comme le jardin communautaire de Saint-Robert. J’ai découvert que j’aimais le jardinage », raconte-t-elle.
Séduite par l’accueil reçu lors d’un congrès scientifique, elle travaille aujourd’hui à l’UQAR à la promotion des programmes de génie et d’informatique.
« Montréal, c’est vraiment autre chose. Ici, j’ai un cercle d’amis très fort, alors je vivais davantage d’isolement. Je dis aux jeunes de profiter de bons programmes à l’UQAR avec une approche très humaine. »




 Par
Par