Van Gogh, génie de la science ? Pas si vite !
L’Institut des sciences de la mer de Rimouski remet les pendules à l’heure
Une équipe de scientifiques de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) taille en pièce une étude de chercheurs chinois et français sur le célèbre tableau « La nuit étoilée » de Van Gogh.
L’an dernier, leurs travaux concluaient que le peintre était un génie de la science parce que les spirales et les tourbillons présents dans son œuvre suivaient les lois de la physique de fluides. Une conclusion non fondée, selon des chercheurs de l’ISMER.
En juin 1889, Vincent Van Gogh est interné dans un asile du sud de la France pour soigner une dépression. Il s’est automutilé de son oreille gauche six mois plus tôt. Le peintre est tourmenté. Il peint ce qu’il voit de la fenêtre de sa chambre: un ciel tourbillonnant avec un village imaginaire ajouté au premier plan. Son chef-d’œuvre transmet sa souffrance et son isolement au delà de la simple représentation d’un ciel nocturne.
Les coups de pinceau créent une sensation de mouvement, comme si le ciel était en perpétuelle évolution. C’est cette caractéristique de « La nuit étoilée » qui a attiré l’attention de chercheurs chinois.
Dans un article publié dans le journal scientifique Physics of Fluids l’an dernier, Yianxiang Ma et ses collaborateurs affirment que les turbulences dans le ciel respectent les principes de la mécanique des fluides. Selon eux, Van Gogh était sans le savoir un génie de la science.
Pour le professeur en océanographie physique de l’ISMER, Daniel Bourgault, cette conclusion ne fait aucun sens.

« Il y a de grands génies que l’on idéalise. On veut leur attribuer des capacités extraordinaires, les rendre plus grands que nature. Il y a plein de tableaux avec des tourbillons et des volutes, mais si tu ne t’appelles pas Van Gogh, personne ne s’y intéresse », estime monsieur Bourgault.
Représentation scientifique
Les chercheurs chinois ont utilisé l’analyse spectrale pour étudier la toile de Van Gogh. Ils ont conclu que les tourbillons de la toile sont conformes à la théorie de la turbulence qui décrit comment l’énergie se propage dans les fluides en mouvement.
Lorsque l’air ou l’eau s’écoulent par exemple, le mouvement génère des tourbillons de différentes tailles.
« Ce n’est pas parce que l’on voit des cercles et des tourbillons dans un tableau que ça représente de la turbulence. On est dans une représentation surréaliste d’un ciel étoilé. C’est ce qui rend la toile intéressante, mais on est loin d’une représentation scientifique de la turbulence », croit Daniel Bourgault.
Avec des collègues de l’UQAR, de l’Institut Maurice-Lamontagne et de l’Université de l’Alberta, il signe un article dans une autre revue scientifique.




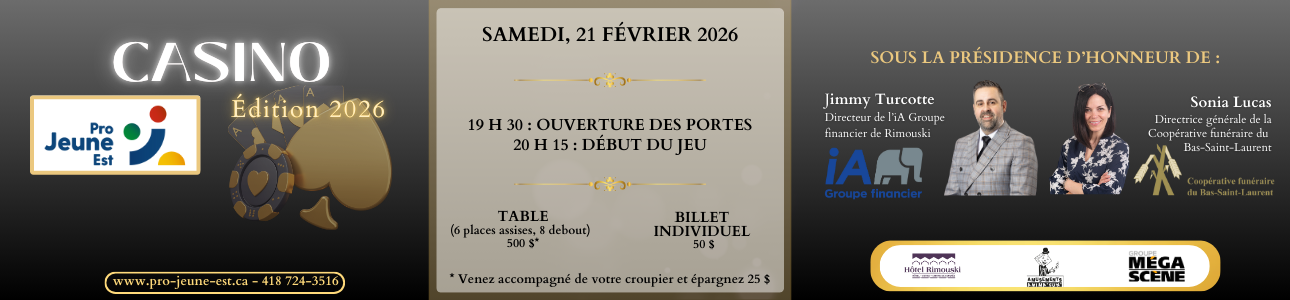
 Par
Par 