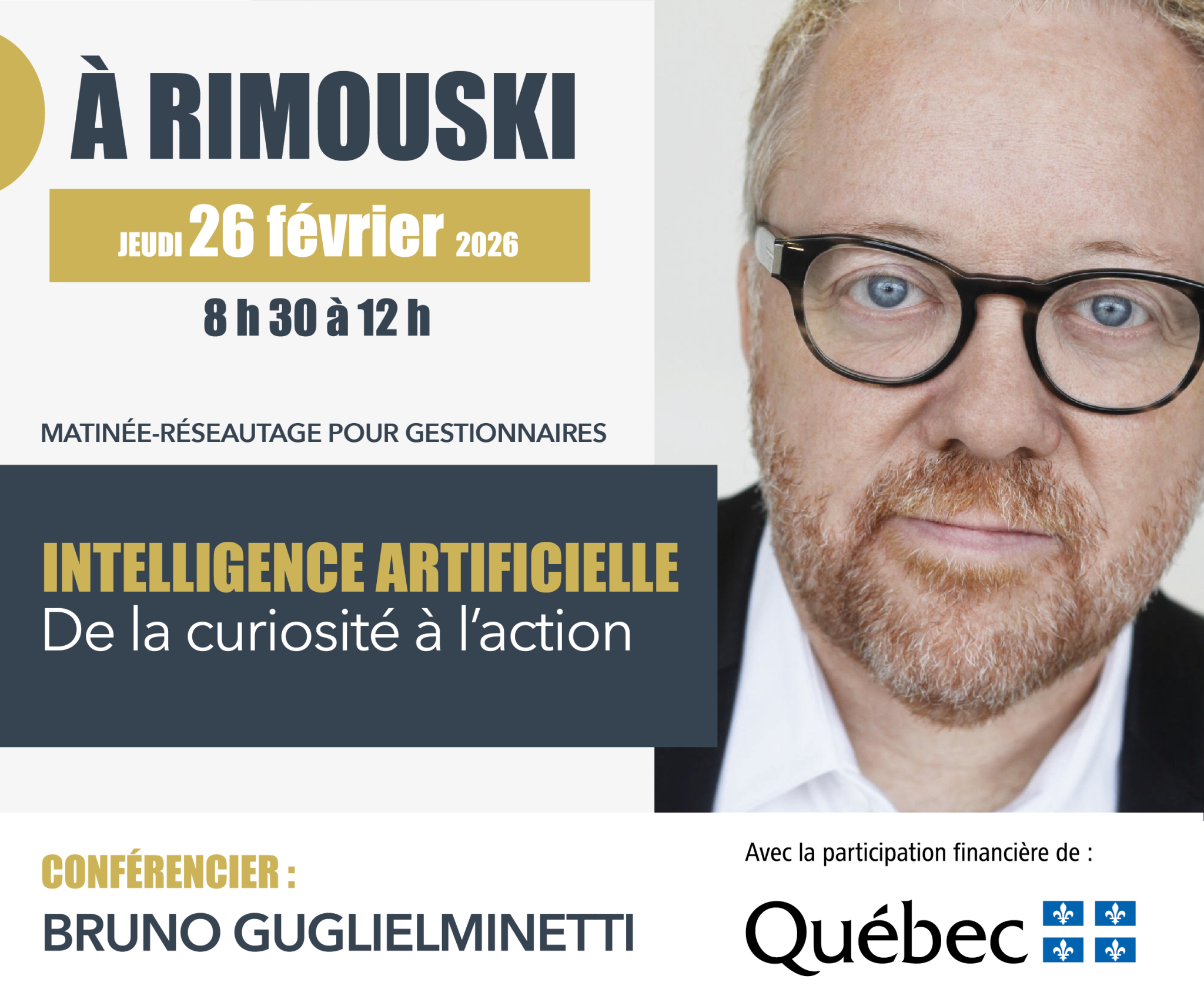Nouvelle ère pour l’industrie du phoque
États généraux du Saint-Laurent présentés à Matane
Un événement historique s’est déroulé du 12 au 14 novembre avec la tenue des États généraux sur le phoque du Saint-Laurent, à Matane. Quelque 90 chercheurs, chasseurs, pêcheurs autochtones et allochtones ainsi que décideurs se sont penchés sur l’avenir d’une industrie en pleine renaissance.
« Les États généraux visaient à moderniser la réglementation et le cadre législatif qui entoure la filière du phoque », explique la directrice générale d’Exploramer et instigatrice de cette démarche participative, Sandra Gauthier. Trois enjeux majeurs étaient à l’ordre du jour : la réglementation, la science et la valorisation de la ressource.
Cette initiative est arrivée à un moment charnière. Le déclin des stocks de poissons, comme le maquereau et le hareng, a placé plusieurs pêcheurs pélagiques sous moratoire, les privant de leur gagne-pain. Pour ces travailleurs de la mer, la chasse au phoque représente une nouvelle avenue de diversification économique.
L’objectif est d’utiliser le phoque dans son entièreté. Viande, graisse et fourrure doivent générer des revenus de façon durable.
« C’est comme si c’était bon pour les autres, jamais pour nous », déplore madame Gauthier en évoquant la tendance à privilégier l’exportation. Cette fois, le marché québécois est ciblé en priorité.
27 recommandations
Un total de 27 recommandations ont été débattues. Celles-ci étaient le fruit de consultations publiques et de mémoires déposés durant l’été.
Coorganisé par l’Association des chasseurs de phoques intra-Québec, l’Agence Mamu Innu Kaikusseth et Exploramer, l’événement a bénéficié du financement des gouvernements provincial et fédéral.
Les États généraux ont pris fin sur une assemblée officielle présidée par le juge à la retraite Robert Pidgeon, ancien maire de Gaspé, afin de formaliser les recommandations qui seront présentées aux gouvernements d’Ottawa et de Québec.

« Je pense que c’est le début d’un temps nouveau », conclut Sandra Gauthier avec optimisme.
Des paramètres pour une chasse durable
Les populations de phoques sont abondantes dans l’est du Canada. C’est ce qui ressort du portrait dressé par Jean-François Gosselin de Pêches et Océans Canada lors des États généraux sur le phoque du Saint-Laurent.
Sa présentation avait notamment pour objectif de définir les paramètres d’une chasse commerciale durable. Selon le biologiste et chef de section des mammifères marins, acoustique et conservation marine à l’Institut Maurice-Lamontagne de Mont-Joli, le phoque du Groenland, qui est l’espèce la plus abondante, a vu sa population chuter dramatiquement depuis 1998.
« Après avoir atteint un sommet de 7,5 millions d’individus, la population est tombée à 4,4 millions en 2024, se situant maintenant dans une » zone de prudence », selon l’approche de précaution adoptée par le ministère », précise monsieur Gosselin.
Plusieurs facteurs
Cette diminution serait liée à plusieurs facteurs, notamment l’absence de glace, les conditions d’alimentation et la mortalité des jeunes. Malgré ce déclin, la chasse commerciale demeure possible avec des quotas stricts. Ainsi, jusqu’à 253 000 phoques du Groenland pourraient être prélevés si 95 % de la récolte cible les jeunes sevrés.
Pour le phoque gris, dont la population est estimée à 366 000 individus en 2021, un quota de 67 300 captures est jugé soutenable dans les mêmes conditions. Les sites de reproduction ont d’ailleurs migré des banquises vers les îles du golfe en raison du réchauffement climatique. Quant au phoque commun, qui est beaucoup moins abondant avec 25 200 individus recensés, les scientifiques adoptent une approche ultraconservatrice, limitant les prélèvements à seulement 720 animaux.
Chasse au blanchon : le débat est relancé
Une question controversée a refait surface aux États généraux sur le phoque. La possibilité de rouvrir la chasse au blanchon, interdite depuis 1987, a soulevé de vifs débats parmi les acteurs de l’industrie du phoque qui ont pris part à l’événement, qui s’est tenu à Matane du 12 au 14 novembre.
Pour le chercheur émérite de Pêches et Océans Canada et retraité de l’Institut Maurice-Lamontagne, Mike Hammill, cette interdiction découle davantage de considérations éthiques que scientifiques.
« Le rapport Malouf, publié en 1987, recommandait de fermer cette chasse, explique-t-il. Ce n’était pas un aspect scientifique, mais plutôt une question d’image. »
Les scènes diffusées à la télévision d’un chasseur frappant un blanchon avec un gourdin avaient profondément choqué l’opinion publique, même si cette méthode était reconnue comme efficace sur le plan du bien-être animal. Depuis la dernière grande vague de chasse, soit de 1995 à 2013, l’industrie a travaillé d’arrache-pied pour démontrer l’évolution de ses pratiques, de l’avis du scientifique.

« Toutes les images qui montrent la chasse au blanchon datent des années 1960 et 1970 », précise monsieur Hammill, soulignant les efforts déployés pour éduquer le public sur les nouvelles méthodes employées.
Adopter une nouvelle approche
S’il ne s’oppose pas à une réouverture de la chasse au blanchon, le chercheur demeure néanmoins catégorique : il faudra adopter une approche radicalement différente. Il suggère notamment le pistolet d’abattage, qui est utilisé dans les abattoirs, bien que cette méthode nécessiterait des
tests approfondis.
Sur le plan strictement scientifique, lever l’interdiction serait acceptable, admet le chercheur émérite. Toutefois, « c’est dans l’éthique et les valeurs de la société que ce n’est pas acceptable pour le moment ».
Monsieur Hammill demeure tout de même sceptique quant à la pertinence de rouvrir ce débat.
« Est-ce que le monde veut investir dans une approche qui a été éliminée pour retourner avec la même bataille ? C’est comme courir après le trouble », croit-il, tout en invitant l’industrie à réfléchir sérieusement aux répercussions d’une éventuelle décision.




 Par
Par