Découvrir la littérature japonaise, une partie d’échecs à la fois
"Grandir est un drame."
Ce n’est un secret pour personne qui passe plus de 5 minutes en ma compagnie : je suis un nipponophile invétéré et décomplexé! Tout ce qui provient du Japon me fascine : sa langue, sa culture raffinée, son histoire sanglante et ses crises existentielles. Il va sans dire que la foisonnante et millénaire tradition littéraire japonaise n’a pas échappé à ma dilettante exploration de la culture nippone.
Je compte, parmi les quelques écrivains dont j’ai à ce jour effleuré l’œuvre, Haruki Murakami, Matsuo Bashô, Junichirô Tanizaki, Soseki et celle que j’en suis venu à considérer comme mon âme sœur littéraire : Yôko Ogawa. Je dois à cette prolifique romancière contemporaine un roman paru en 2003 (traduction : 2005) et dont je suis éperdument jaloux. Quiconque écrit ou aspire à le faire un jour vous le dira: il arrive tôt ou tard un moment où on tombe, bien souvent par hasard, sur un texte qu’on regrette de ne pas avoir pu écrire soi-même. Pour moi, cette révélation m’est venue de La formule préférée du professeur.

Yôko Ogawa. Crédit photo: Leméac Éditeur 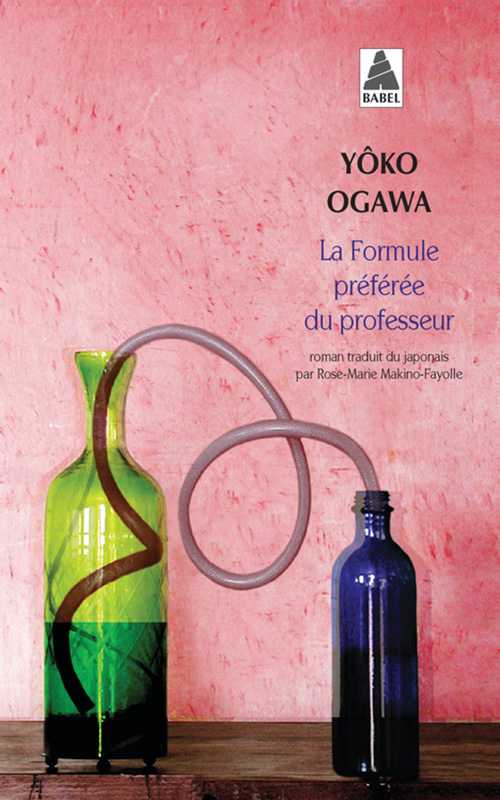
Crédit image: Éditions Actes Sud
Peut-être y reviendrai-je un jour dans une chronique, mais aujourd’hui j’aimerais plutôt m’attarder au dernier roman de Yôko Ogawa que j’aie lu: Le Petit Joueur d’échecs (2009 [traduction : 2013]). Si La formule préférée du professeur avait fait vibrer ma corde sensible en combinant les sciences et la poésie du quotidien, j’ai découvert dans Le Petit Joueur d’échecs un univers bien plus étrange. On y suit l’histoire d’un jeune garçon surnommé « Le Petit Alekhine » venu au monde avec les lèvres soudées. Après l’accouchement, pour lui offrir la chance de manger et de respirer, le docteur fendit les lèvres du nouveau-né à l’aide d’un scalpel avant de greffer sur la plaie un peu du tissu duveteux de son mollet. Traumatisé par cette blessure originelle, le jeune garçon grandit dans le silence et l’isolement, ne comptant pour amies que les spectres d’Indira, éléphante morte de vieillesse sur le toit d’un centre d’achats, et de Miira, jeune fille qui, selon la légende, serait restée coincée dans l’interstice entre deux maisons pour y mourir dans l’indifférence générale. Le jeune garçon fera plus tard la connaissance du Maître, un homme obèse morbide confiné à un autobus désaffecté dans lequel il enseignera au petit à jouer aux échecs.
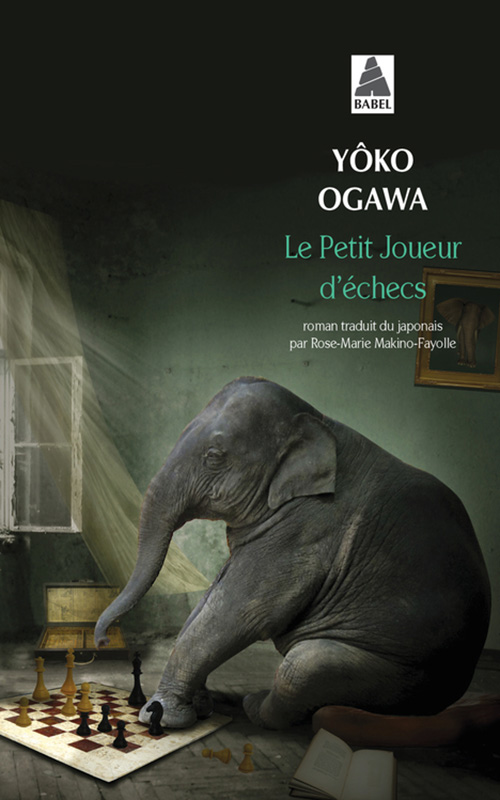
Crédit image: Éditions Actes Sud
Même si le ton du Petit Joueur d’échecs est radicalement différent de la zen et émouvante contemplation de La formule préférée du professeur, on y retrouve toujours la sensibilité et la douceur des mots de Yôko Ogawa qui, au détour de chaque ligne, risque de vous surprendre avec l’une de ces phrases si justes et efficaces qu’elles vous vont droit au cœur :
« Quand les enfants le réclamaient, Indira les soulevait très haut avec sa trompe dont elle était si fière, l’air de dire que s’il n’y avait que cela pour leur faire plaisir c’était facile. Le bruit de la chaîne raclant le sol était étouffé par les cris de joie. » (p. 12)
On distingue, dans la littérature japonaise, une étrangeté bien particulière qu’on peine à retrouver ailleurs. Une étrangeté qu’on pourrait de prime abord confondre avec l’absurde. Ceux qui ont déjà lu Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami savent de quoi je parle.
Il y a des années de cela, je suis tombé sur une représentation graphique des formes que peut prendre la pensée au contact de différentes langues. Si la pensée est un point, imaginez qu’elle se déplace le long d’une ligne pour atteindre sa conclusion ; or, le parcours que suit la pensée varie en fonction de la langue qui la porte. Dans ce graphique, la pensée française prenait la forme d’un escalier, chaque marche menant naturellement à la suivante. La langue française, avec sa syntaxe rigide, sa grammaire complexe et ses dizaines de temps de verbe se veut le vaisseau de la raison ; la langue des fines nuances et des subtiles modulations de sens. Tout ce qui suit découle de ce qui précède, et nulle conclusion n’est parfaitement valide si pour y arriver nous n’avons pas au préalable égrainé un chapelet de prémisses logiques.
Dans ce même graphique, la pensée japonaise était dépeinte comme une spirale. Langue des 1001 détours, le japonais impose un canevas logique moins rigide que le français. Dans la grammaire japonaise, nulle distinction entre féminin et masculin, pas non plus de différence entre singulier et pluriel ; au bas mot deux temps de verbes (le passé, et le « non-passé », oui-oui), mais un système d’écriture usant de milliers d’idéogrammes plus proches du hiéroglyphe égyptien que de la lettre latine. Dans la syntaxe japonaise, c’est le verbe qui clôt chaque phrase. Or, comme les verbes se partagent une poignée de terminaisons différentes (un peut comme les verbes français qui se terminent tous en -er, -ir, -oir, -re, etc.), il s’avère que faire rimer deux vers en japonais n’a rien d’exceptionnel ou même d’esthétique.
La poésie japonaise repose donc sur la composition d’images et sur leurs interactions, encore davantage qu’en français. Des images juxtaposées, laissées là dans l’espoir qu’en les observant simultanément on puisse faire jaillir quelque chose de l’espace laissé vacant entre elles. Le sens japonais est affaire de contexte bien plus que de logique, d’interprétation davantage que d’inférence. C’est selon moi de là que provient, du moins en partie, cette « étrangeté » de la littérature japonaise qui tend à nous désarçonner, nous esprits occidentaux.
« Il ne savait pas au juste ce qu’était la poésie, mais si l’on qualifiait de poème le calme qui s’élevait des transcriptions d’Alekhine comme une brume matinale, la délicatesse d’un pétale qui tremble sous la brise, un éclair fulgurant, les ondulations du vent rugissant à travers la steppe, la solitude de la lune se découpant dans l’obscurité, alors il était persuadé que ce qu’on appelait poésie était un magnifique joyau. Chaque coup d’Alekhine formait un vers qui s’incrustait profondément dans son cœur. » (p. 73)
Aucun « lien logique » n’unit les lèvres poilues du petit joueur d’échecs au souvenir d’un éléphant mort sur un toit de supermarché ou au fantôme d’une fillette oubliée de tous dans l’espace exigu entre deux maisons. Pas de rapport de cause à effet. Pas de conclusion à tirer ou d’argument à défendre. Seulement le liant symbolique du danger de l’emprisonnement, de l’inévitabilité du deuil, de la peur de grandir et de la poésie des petites choses.




