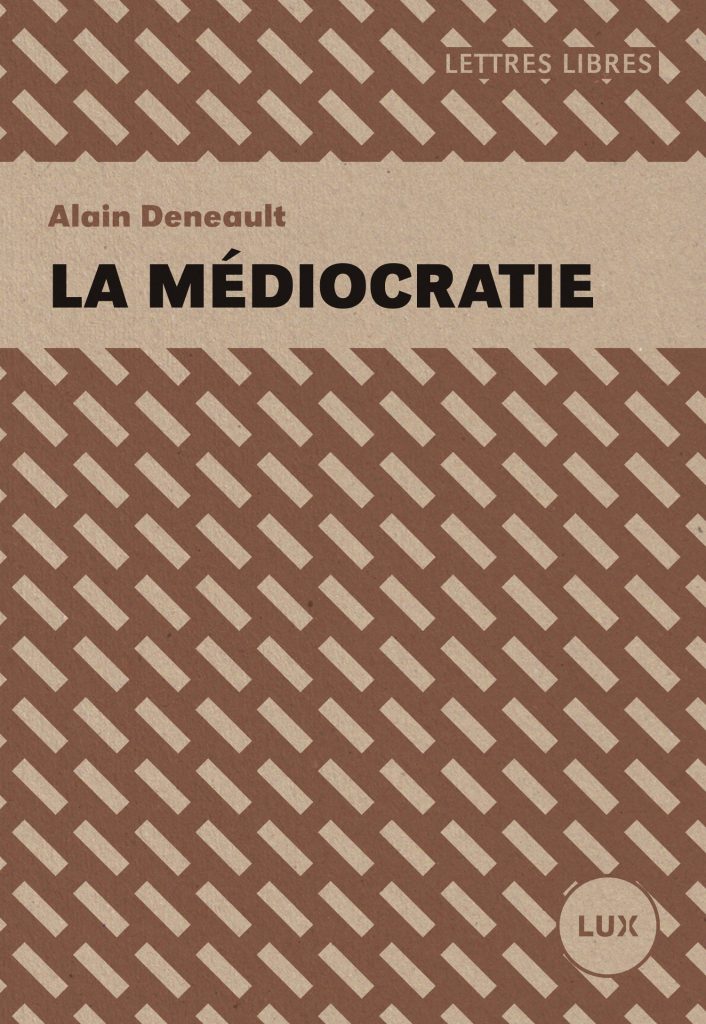La tyrannie du milieu

La littérature nous aide. Elle nous aide à réfléchir et, par la réflexion, à mieux comprendre ce qui nous unit et nous distingue dans nos cultures, nos histoires, nos identités de genre, nos sexualités. Nos perspectives sur ce que « vivre » signifie. Par la lecture, on peut prendre conscience de l’universalité de ce qui nous arrive tout en apprenant ce que le regard d’autrui a de singulier. Par le biais de la littérature, on peut se frotter aux réalités d’être mère, vétéran de guerre, astronaute ou dépressif sans jamais l’avoir été soi-même.
Mais il arrive parfois – à ceux qui, comme moi, se lassent périodiquement de « l’art pour l’art » – des moments où l’on ressent le besoin d’aborder sans allégorie ni empathie narrative des questions non moins pertinentes et profondes sur la réalité concrète des systèmes politiques, économiques et sociaux dans lesquels nous évoluons. Or, pour ces moments, il y a la pléthore d’essais politiques qui sortent chaque année au Québec. Des essais comme ceux du philosophe Alain Deneault qui déplore, dans La Médiocratie, l’avènement de ce qu’il désigne comme le règne de la médiocrité dans toutes les sphères de pouvoir politiques, culturelles et économiques :
Il n’y a eu aucune prise de la Bastille, rien de comparable à l’incendie du Reichstag, et l’Aurore n’a encore tiré aucun coup de feu. Pourtant, l’assaut a bel et bien été lancé et couronné de succès : les médiocres ont pris le pouvoir.
Le terme « médiocrité » est à prendre ici dans son sens étymologique de ce qui appartient au milieu, au centre. « Médiocre » de « ce qui est moyen ». Pour Deneault, cette « médiocratie » s’est solidement implantée dans les domaines de la culture, de l’économie et, oui oui, même de la recherche universitaire. Les universités d’ici comme d’ailleurs, assumant pleinement leur mariage d’intérêt avec le secteur privé, en viennent à présenter l’acquisition de connaissances non plus comme une quête en soi consacrée à repousser les limites de la sagesse humaine, mais plutôt comme un outil parmi tant d’autres mis à la disposition des marchés mondiaux dans ce qu’ils en sont venus à appeler sans la moindre trace d’ironie « l’économie du savoir ».
Mais d’aucuns me répondront : « qu’y a-t-il donc de mal à mettre la connaissance et la recherche universitaire au service de la prospérité collective? » Ce à quoi Alain Deneault serait susceptible de répondre : « Rien, tant que nous n’en faisons pas, comme c’est le cas en ce moment, sa vocation première ». C’est qu’à force de chercher perpétuellement des moyens de « valoriser » ou de « faire fructifier nos investissements collectifs en éducation », nous en venons à privilégier un certain type de connaissance et de savoir : celui qui a fait ses preuves, celui dont on sait qu’il « rapporte » :
Alors qu’elle est obsédée par la question de l’employabilité de ses diplômés, l’université ne semble pas se soucier de faire comprendre au public en général en quoi consistent les disciplines autres que le génie, l’administration, la médecine, la psychologie, le droit et quelques autres. La société qui finance les institutions ne se fait pas clairement expliquer la pertinence des études littéraires, de l’urbanisme ou de la sociologie sur le cours de la vie, probablement parce que les chercheurs eux-mêmes n’ont plus le temps de se poser la question.
Pour avoir vu moi-même combien certains départements d’ingénierie et d’informatique peuvent se voir ensevelis sous les subventions et rénovés plus souvent qu’à leurs tours alors que tombent littéralement en ruine les pavillons voisins où l’on enseigne les sciences humaines ; pour avoir vu, aussi, ne serait-ce que brièvement, la valse des demandes de subvention et la pression constante pour « formater » nos projets de recherche aux « goûts du jour » pour s’attirer les bonnes grâces des organismes subventionnaires, je comprends bien ce à quoi fait référence Deneault. Le portrait que dresse Deneault du milieu universitaire est sombre et franchement peu flatteur : réduite à guère davantage qu’un appendice du secteur privé qui qui boit à grandes lampées à cette fontaine de recherche alimentée de deniers publics, l’université fait pression sur les professeurs et les étudiants pour combler les désirs de ses « généreux » mécènes.
Je ne m’attendais pas à ce que mon article de ce mois-ci se fasse sur un ton aussi politique. Or, le destin m’a quelque peu forcé la main. Alors que j’écoutais, le 24 juillet dernier, l’émission RDI économie, j’y ai appris l’existence d’un nouvel organisme dédié à « la valorisation de la recherche publique ». Je n’ai aucun doute que si monsieur Deneault était, comme moi, devant son téléviseur à cet instant, il aurait sourcillé en entendant la journaliste demander à monsieur Luc Sirois, directeur général de Prompt :
« Et puisqu’on parle de valorisation et de maximiser la portée économique de la recherche publique, est-ce que, donc, on peut dire qu’elle ne génère pas assez de retombées en ce moment? »
Ce à quoi monsieur Sirois lui répondit : « On peut toujours aller plus loin! » Mais c’est bien là le problème que souligne Alain Deneault : à force de constamment faire des impératifs du marché les forces premières motivant le financement et le développement de la recherche, on s’enlise dans un statu quo qui tue la spontanéité et la prise de risque nécessaires à l’exploration de l’inconnu. Il en va de même pour la domination de la « culture » par « l’industrie du divertissement » ou des crises économiques cycliques générées par la spéculation boursière et les renflouages des banques sur le bras des contribuables.
Alain Deneault a-t-il raison sur toute la ligne? Dur à dire. Il y aurait tant à analyser, à interpréter, à contre-vérifier. Mais le simple fait qu’un texte puisse nous mener, moi comme vous, à nous poser de telles questions et à remettre en cause ce sur quoi nous ne nous sommes peut-être même jamais attardés, ce simple fait, donc, en vaudra toujours la chandelle.